Comment, faire voyager un aveugle (il faut dire « malvoyant » aujourd'hui) ? Mais ça ne sert à rien puisqu'il ne voit pas les paysages ! Faire voyager un sourd (dire « malentendant ») ? Mais il ne comprendra rien... Un handicapé mental (dire « individu aux fonctions cognitives altérées ») ? Vous croyez que ça leur sert à quelque chose ? Une personne en fauteuil (dire « à motricité compensée ») ? Elle ne serait pas mieux chez elle ? Voyager avec son oxygène, mais il est inconscient ! Et sa maladie génétique, on ne va pas l'attraper ? Ce florilège récent (2011) d'idées reçues, de peurs de l'autre non assumées, du questionnement qu'amène l'apparente ou invisible différence légitime plus encore ce guide dont nous n'avons pas la naïveté de penser qu'il est parfait, complet et qu'il porte les voyages adaptés depuis la France sur les ailes du bonheur enfin acquis. Car tout ou presque reste à faire, en particulier dans le domaine de ce que nos voisins nordiques appellent l'accessibilité universelle. Mais il témoigne d'engagements, de rencontres, de luttes aussi.
Un avertissement au lecteur : par commodité, nous utiliserons indifféremment les adjectifs « adapté » ou « accessible », alors que premier terme désigne plutôt les voyages pour les personnes en situation de handicap mental. Le Processus de Production du Handicap canadien utilise « déficient » versus « intègre », désignant altération organique ou intégrité physique. Ce vocabulaire-là (qui a sa pertinence) n'est pas suffisamment utilisé chez nous pour que nous l'adoptions ici.
Un peu d'histoire
Comme tout a un début, lui-même précédemment relié à un processus antérieur, nous reviendrons d'abord sur ce qui a fondé en France le tourisme adapté puis nous ferons un tour d'horizon des engagements internationaux auxquels ont souscrit 140 pays et, enfin, nous tenterons un bilan de l'existant face à ce qui devrait être au moins en cours d'acquisition.
Tourisme, voyage supposeraient mobilité... C'est bien ainsi que la culture touristique s'est développée à partir de 1936, année où les congés payés sont devenus un droit dans notre pays. Notons d'ailleurs que pour avoir des congés, il faut avoir un travail et que ce non-droit-là, pour de nombreuses personnes en situation de handicap, a longtemps dissimulé et l'invisibilité du handicap et la prédominance du médical sur la citoyenneté. Ne jetons pas la pierre, pourtant, à ceux qui, à la fin du XIX e siècle et au début du XX e ont pensé qu'il serait salutaire d'amener les malades (terme de l'époque) au grand air. La grippe espagnole a tué 410 000 personnes en France entre 1918 et 1919 (plus que la guerre elle-même), les invalides sont là, la tuberculose tuera inexorablement jusque dans les années 50, la poliomyélite ne cède guère avant les années 60... D'où la vogue des préventoriums, sanatoriums, centres de cure hélio-marins où l'on isole l'individu (jusqu'à le faire périr... d'ennui) prétendument des virus mais peut-être surtout du monde « normal ». Berck-Plage accueille ses « allongés », les Alpes et les Pyrénées les « tubards ». Deux aspects vont converger : les progrès médicaux et l'effet de groupe. Les premiers vont éloigner peu à peu le spectre de certaines maladies ou à tout le moins permettre aux malades de « vivre avec ». Moins dans la terreur quotidienne, certains parents vous pouvoir se regrouper, disposant d'un peu plus d'autonomie dans un emploi du temps désormais moins chargé par le médical, et créent des associations (dites auto-support parce qu'elles ne gèrent que « leur » handicap) dont certaines prendront l'initiative de créer des centres de vacances. On sait moins que certains patients (souvent des femmes, comme Marguerite Rivard, Suzanne Fouché) ont voulu que soit pensé l'après-sanatorium, avec des activités, des cours, des préparations à des métiers. Et que se sont joints à ces initiatives des « valides », des religieux, des médecins, des militants. C'est ce deuxième aspect (l'effet de groupe) qui est l'origine de la plupart des associations actuelles. Et c'est l'Association des Paralysés et Rhumatisants (devenue depuis l'Association des Paralysés de France, APF) qui lance en 1936 la première colonie pour jeunes filles paralysées.
Non moins importants, par leur engagement précoce (certains dès 1920) notamment ont été (et le sont toujours) les mouvements scouts. Sous-tendent leurs actions la conviction profonde que la santé du corps fait partie de la santé mentale, que les loisirs sont faits pour tous (naissent des groupes de vacanciers mixtes, que l'on appelle aujourd'hui d'intégration). Scouts et Guides de France, Eclaireurs et Eclaireuses de France, Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes, Eclaireurs et Eclaireuses Israélites de France et Scouts Musulmans de France apportent ainsi des pierres plus qu'honorables à l'édifice des loisirs adaptés puis des séjours et vacances adaptés. Ils portent aussi la conviction « charitable » qu'aucun d'entre nous ne doit rester sur le bord de la route au motif qu'il est différent 1. Enfin, il faut attendre les années 90 pour que, logique économique aidant, certains tour-opérateurs mettent à leur programme des séjours où l'accessibilité fait partie intégrante de l'offre. Notons d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux sont en situation de handicap et que, partant de leur propre envie de bouger et des frustrations qu'ils rencontrent alors, ils décident de se lancer professionnellement.
Les outils de la professionnalisation
Les années qui suivent voient se succéder (sans qu'il s'agisse ni de priorité nationale ni internationale, tout de même !) commissions, études, labels, textes de lois, réglementations, conventions, résolutions dont l'étude faite isolément tendrait à faire penser que les voyages accessibles sont devenus une affaire d'Etats. En tout cas, au même titre que le droit à l'éducation, au travail, à la santé, à la non-discrimination, le droit à l'accès aux loisirs et à la culture entre dans les cadres qui fixent et renforcent les droits de l'Homme partout dans le monde. Et les pays signataires (notamment de la Convention des Nations Unies, 2007) s'engagent à rendre compte, chaque année, des progrès réalisés. En 1991, l'assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme (en anglais WTO, puis UNWTO) avait élaboré une résolution intitulée Créer des opportunités touristiques pour les personnes en situation de handicap. Son intérêt est de recenser ce qui est nécessaire pour qu'un voyage, un séjour soit vraiment accessible : l'information et la communication avec le public concerné (y compris via les langue des signes et le braille), la formation des professionnels, la mise en place de structures bâties (ou l'adaptation de l'existant) comprenant systématiquement l'accessibilité (parking, chambres, douches, toilettes, téléphones surbaissé, boucles magnétiques, informations visuelles, auditives, ascenseurs), la politique de coûts raisonnables, de transports accessibles, l'accès aux monuments, musées, la possibilité de participer aux excursions. Cadre créé, recommandations fondées diffusées à tous, Michel Gagneux (inspecteur général de la santé et rapporteur auprès du Conseil national du tourisme) fait pourtant en juin 1999 une sinistre constatation 2 : « En matière d'accessibilité aux handicapés, le tourisme français réceptif en est à ses balbutiements. Malgré les effets d'annonce et nombre d'initiatives méritoires, les expériences restent rares et isolées. Cela est dû en partie au fait que l'accueil des personnes handicapées n'a jamais été appréhendé sous l'angle économique ; les seules approches ayant prévalu étant les approches morale et légale. La première est liée à notre culpabilité envers les handicapés. La seconde stigmatise l'accessibilité comme une contrainte supplémentaire pour le gestionnaire ou l'exploitant. » En 2011, sur le territoire français 2 % environ des infrastructures dédiées ou liées au tourisme sont labellisées Tourisme et handicap, pourcentage que l'on retrouve aussi à « l'international », avec des disparités on s'en doute. Ainsi, l'Espagne, sous la férule de la puissante ONCE (Association des aveugles espagnols) et d'une politique très volontariste du ministère du tourisme fait évidemment mieux que le Chili ou la Tanzanie...
Le tourisme adapté : un mieux pour tous
« Les handicapés n'ont jamais été considérés comme un segment de clientèle à part entière, avec des besoins spécifiques auxquels l'offre se doit d'apporter une réponse adéquate. Car, au-delà de la nécessaire solidarité nationale, qui sous-tend notamment la campagne pour l'accès des personnes handicapées aux vacances et aux loisirs, les solutions apportées peuvent être sources de revenus pour l'industrie touristique » , poursuivait Michel Gagneux. Justement, parlons économie : dans la seule Europe, 10 % de la population est en situation de handicap (ce chiffre se retrouve à peu près partout dans le monde), 25 % des Européens ont un parent handicapé, 40 % des personnes handicapées n'ont jamais pris 1 jour de vacances ! L'Enat (European Network for Accessible Tourism) a donc calculé en 2010 que le tourisme accessible européen pourrait concerner 130 millions de personnes (27 % de la population européenne) et dégager 68 billions d'euros par an ! Et 785 millions d'individus recensés sont concernés par le handicap dans le monde. Sans compter ceux qui ne le sont pas : les accompagnants (parents, amis), les personnes atteintes du HIV, souvent exclues des statistiques comme les enfants malades, ceux qui vivent dans des pays où les recensements ne sont pas faits, ou truqués pour ne pas avoir à se mettre aux normes... Evidemment cela ne signifie pas que tous deviendraient des touristes sur leur territoire et hors de chez eux, mais il suffit d'ajouter à ces chiffres ce que l'on sait déjà des bénéfices réalisés en termes d'emplois spécialisés (information, communication, hôtellerie, centres de vacances, bases de loisirs, lieux culturels, restauration, architecture, transports, équipements, services d'aide, de soins...) pour que tombent les arguments de tous ceux qui freinent en disant que l'accessibilité est bien trop chère. La demande de tourisme accessible, dans sa conception du tourisme pour tous, est en pleine expansion. C'est une opportunité formidable plutôt qu'une obligation. Si l'industrie du tourisme veut maintenir et développer la qualité, la durabilité et la compétitivité, il faudra encourager et développer le tourisme pour tous. Les responsables du tourisme, que ce soit au niveau des gouvernements ou des opérateurs impliqués, ont pris conscience il y a quelques années qu'il était nécessaire de freiner un tourisme bétonneur, de mesurer le coût écologique des transports, de manifester aux populations visitées un vrai respect. Le tourisme sexuel est désormais dénoncé avec fermeté. Ce sont là de gros progrès et il ne faudra pas se relâcher. Alors pourquoi tant de timidité de la part de 98 % des opérateurs français (le tourisme accessible de la France vers l'étranger représente 2 % du total des voyages annuels) ? Pourquoi admettent-ils de ne pas emmener ces « voyageurs-là » ? C'est très précisément parce que cela ne paraît pas indispensable, en un mot, ordinaire, que tant de freins persistent, qu'il est difficile de trouver des hôtels, des campings, des plages, des musées accessibles. Comment admettre qu'une personne désirant faire un voyage sur le thème de l'histoire et de la culture ait été reçue avec une condescendance méprisante par un voyagiste, comme si sa demande était obscène, comme si sa place était ailleurs, pourquoi pas là où on ne le verrait pas ? Osons un postulat : face à une culture de la performance, du corps qui ne vieillit pas, du succès qu'il faudrait obtenir à tout prix, le handicap ne représente-t-il pas ce qui fait désordre, ce qui fait tache, en un mot peur. Comme s'il était contagieux. Ne nous voilons pas la face : en France comme ailleurs le chemin sera long, très long, terriblement long avant que chacun soit considéré non pour son apparence, non pour ses défaillances supposées, mais comme un individu au sens plein du terme.
Ceux qui se sont engagés un jour sur la voie du tourisme accessible ont travaillé au-delà de l'imaginable pour que vous puissiez aussi faire du rafting, de la voile, du quad, faire une promenade à cheval ou à dromadaire, pour que ces voyages soient beaux, inoubliables. Ils témoignent tous de ce travail inlassable qu'il leur faut accomplir mais aussi de joies extraordinaires lorsque leurs voyageurs handicapés visuels abordent le désert marocain, emplis d'odeurs, de sensations que leurs guides valides ne perçoivent pas. Lorsque un couple handicapé mental peut voyager, avoir sa chambre. Lorsque des voyageurs sourds ont réussi à communiquer à Kyoto avec un jeune Japonais également sourd. Lorque deux jeunes partent faire leur voyage de noces "sur roulettes" au Pérou ! Et parfois, l'aventure a même commencé tout près, comme pour cette association installée dans une banlieue si décriée qui a trouvé ses contacts, ses hébergements grâce aux associations d'émigrés. Formidable que ceux qui ont fait un voyage qui n'a jamais ressemblé au tourisme soient accompagnants de ceux pour qui partir relève souvent du défi ! Formidable aussi qu'au Pérou, des élèves aide-soignantes péruviennes accompagnent un tour-opérateur français et acquièrent ainsi une expertise qu'elles sont capables de redistribuer autour d'elles. Et qu'en Thaïlande, l'atelier de réparation des fauteuils roulants de Chiang Mai n'emploie que des travailleurs handicapés qui répareront le vôtre...
Les échanges humains se créent (inquantifiables en termes économiques), aidant les uns et les autres dans leurs combats contre la discrimination. La venue de touristes déficients visuels, auditifs, handicapés mentaux ou moteur n'a pas peu aidé ceux qui se cachaient au sein de leur pays, discriminés, honteux, désignés comme porteurs de tares ou de malédictions, à oser faire valoir leurs droits, à se constituer en associations. Et pour chaque enfant qui accédera à l'école, pour chaque femme qui pourra peut-être un jour travailler, où que ce soit dans le monde, parce que d'autres lui en auront donné la force, venus parfois de loin, riche de leur propre combat, cela vaut évidemment formidablement la peine que le tourisme se donne les vrais moyens d'être accessible à tous.
Le tourisme accessible est militant. Il ne peut en être autrement puisque l'accessibilité universelle fait l'objet de remises en cause régulières. Transporteurs autocaristes qui peuvent demander des dérogations (en France), dérogations aussi possibles sur les habitats temporaires (caractéristiques des hébergements touristiques) en France toujours, toilettes des restaurants régulièrement inaccessibles (et dans de trop nombreux trains ou avions court-courriers)... Allons voir ce que la municipalité d'Arona (Ténérife) a fait dans sa petite ville où acheter son dentifrice ne pose pas plus de problème que d'aller flotter dans une belle eau bleu turquoise ou se rendre au cinéma en fin d'après-midi, qu'on soit en fauteuil, avec des difficultés auditives ou visuelles. Mais cela, touristes handicapés, municipalité, voyagistes, architectes l'ont voulu. Ensemble.
« Je ne pourrai me sentir citoyen de la Terre que le jour où notre valeur humaine intrinsèque d'êtres différents sera reconnue partout sans hiatus. Le jour où nous aurons le choix de nos modes et lieux de vie. Le jour où nous pourrons circuler en toute indépendance où que nous allions. Le jour, enfin, où nous ne serons plus cantonnés dans des ateliers protégés ou des établissements spécialisés par facilité et confrontés à des avanies dans certains endroits publics parce que notre apparence dérange. Mais ce jour-là ne viendra que si les regards s'ouvrent sur l'infini humain. » 3
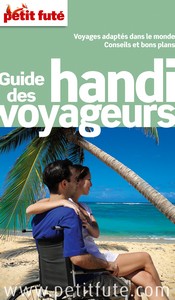
1 Reichhart (François), Tourisme et handicap, L'Harmattan, 2011.
2 Gagneux (Michel), « Faciliter la rencontre entre les touristes handicapés et les professionnels », revue Espaces, 1999.
3 Nuss (Marcel), Un autre regard, colloque Handicap et société, 2006.